« L'état du monde » par Ian Bremmer
- mfellbom
- 29 oct. 2025
- 11 min de lecture
Ian Bremmer est le fondateur de GZero Media, une société qui propose au public une couverture intelligente et captivante de l'actualité internationale. Créée en 2017, elle est une filiale d'Eurasia Group, leader mondial de l'analyse des risques politiques.
Lors du sommet GZERO Japan 2025 à Tokyo en octobre, Ian Bremmer a prononcé son discours annuel sur « l'état du monde », un constat sans concession de notre « ordre post-américain ».
Il prévient qu'aucune puissance n'est disposée ou capable de combler le vide mondial laissé par la crise, plongeant ainsi le monde plus profondément dans une ère de G-Zéro : plus de conflits, plus d'impunité et plus d'instabilité.
Mais son message ne concerne pas seulement les gouvernements, il nous concerne tous : citoyens, entreprises et communautés, qui devons bâtir la coopération et la confiance là où le leadership a failli.
Il s'agit d'une vidéo de 40 minutes qui vaut clairement le détour, offrant une vision claire de la situation mondiale actuelle et, bien sûr, mettant fortement l'accent sur les conséquences des changements qui s'opèrent aux États-Unis sur le reste du monde.
Sinon, prenez 10 minutes pour lire la partie ci-dessous concernant le retrait des États-Unis de leur rôle dans le monde après la Seconde Guerre mondiale :
« Depuis 20 ans, on nous met en garde contre la montée en puissance de la Chine, le déclin de l'Amérique et l'inévitable collision entre les deux superpuissances.
Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui.
Le véritable enjeu de notre monde monde G-Zero, que j'ai exposé lundi lors de mon discours sur l'état du monde à Tokyo, est que les États-Unis – toujours la nation la plus puissante du monde – ont choisi de se retirer du système international qu'ils ont bâti et dirigé pendant trois quarts de siècle. Non pas par faiblesse, ni par obligation, mais par choix.
D'imprévisible à peu fiable
Ce choix est sans précédent historique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants élus américains ont toujours défendu le leadership des États-Unis dans un monde en crise. Dans cette optique, ils ont renforcé leurs alliés afin de les rendre plus forts, plus compétitifs et plus sûrs.
Mais la volonté américaine de diriger fléchit aujourd'hui sous le poids d'une politique de ressentiment. Les citoyens ont de plus en plus le sentiment que les institutions américaines – et nombre de leurs dirigeants élus – n'ont pas tenu leurs promesses et ne les représentent plus. Pour des millions d'électeurs, le contrat social – la promesse implicite que le travail et le respect des règles seraient récompensés par le système – est rompu. Trump est un symptôme, un bénéficiaire et un accélérateur de cette défaillance, mais il n'en est pas la cause.
À mesure que les Américains ont perdu confiance en leur propre système, ils se sont repliés sur eux-mêmes : se détournant de leurs alliés, de la sécurité collective, du libre-échange, des institutions mondiales et du droit international. C’est ce monde du G-Zéro dont je parle depuis des années, un vide de leadership mondial que personne n’est disposé ni capable de combler.
Le fait que les alliés des États-Unis contribuent moins à la table des négociations ces dernières décennies n'arrange rien. L'Europe, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon accusent un retard de productivité et de croissance, sont confrontés à une démographie fragile et ont chroniquement sous-investi dans la défense et l'innovation technologique. Ils sont d'autant plus dépendants de Washington que les Américains souhaitent précisément que leur gouvernement intervienne moins à l'échelle mondiale.
Winston Churchill disait qu'on pouvait toujours compter sur les Américains pour faire ce qu'il fallait – une fois qu'ils avaient épuisé toutes les autres solutions. Les États-Unis ont toujours été imprévisibles : lors des élections, dans les accords commerciaux, et même en matière de guerre et de paix. Mais ils ont rarement manqué de fiabilité.
Aujourd'hui, c'est les deux. Les États-Unis restent attachés aux normes, traités et accords internationaux existants uniquement dans la mesure où ils servent les intérêts du président Trump et de ses alliés politiques. Les gouvernements signent des accords pour ensuite voir Washington en modifier unilatéralement les termes. Le partage de renseignements est suspendu du jour au lendemain. L'aide étrangère vitale est réduite à néant. L'Amérique s'ingère dans la politique intérieure de démocraties amies. Elle menace l'intégrité territoriale d'alliés comme le Canada et le Danemark. Elle impose les droits de douane les plus élevés depuis près d'un siècle. Elle abandonne d'innombrables engagements institutionnels internationaux. La liste est longue. Le manque de fiabilité des États-Unis est devenu le principal facteur d'incertitude et d'instabilité géopolitiques dans le monde actuel, marqué par la mondialisation.
Mais le manque de fiabilité ne représente que la moitié du problème. Pour comprendre l’ampleur du problème – sa profondeur, sa durée, ce qu’il est possible de faire – il faut comprendre ce qui se passe actuellement aux États-Unis : une révolution politique .
En tant que politologue, je n'emploie pas le mot « révolution » à la légère. Il implique un changement fondamental dans la gouvernance d'un pays – une tentative de renverser l'ordre établi et de le remplacer par un système nouveau. Qu'elle soit motivée par l'idéologie, l'identité ou la richesse, une véritable révolution repose toujours sur la capacité et la volonté d'acteurs influents de saisir l'opportunité créée par la conviction, largement partagée au sein de la société, que le système en place est défaillant et, par conséquent, illégitime. En ce sens, les révolutions se font, elles ne naissent pas.
De mon vivant, j'ai assisté à deux révolutions d'État ayant eu un impact véritablement mondial.
La première fut la révolution socialiste de Mikhaïl Gorbatchev. L'Union soviétique perdait depuis longtemps du terrain dans sa compétition de la Guerre froide avec les États-Unis. Une élite du parti déconnectée des réalités et un système économique sclérosé peinaient à maintenir l'État et à financer une course aux armements que Moscou semblait vouée à perdre. Pour enrayer la stagnation soviétique, Gorbatchev lança des réformes internes radicales : la transparence politique ( glasnost ) pour encourager les idées concurrentes, la restructuration économique ( perestroïka ) pour introduire des éléments de marché concurrentiels dans l'économie planifiée, et l'autocomptabilisation ( khozratchyot ) pour décentraliser le pouvoir de Moscou vers les républiques soviétiques.
Ces réformes ont rapidement ébranlé les fondements du système soviétique. Elles ont permis aux citoyens, aux oligarques et aux nationalistes de contester la légitimité du régime, engendrant une opposition interne et une dissidence sociale généralisées. La chute du mur de Berlin et du bloc de l'Est a accéléré la perte de contrôle du Kremlin, et une révolution des nationalités a conduit à la désintégration de l'Union soviétique peu après. La révolution de Gorbatchev a échoué, entraînant dans sa chute l'Union soviétique.
La seconde révolution fut la modernisation économique de la Chine par Deng Xiaoping. À la fin des années 1970, le dirigeant du Parti communiste chinois, face à l'économie socialiste chinoise sous-productive, inefficace et technologiquement stagnante, la transforma d'une économie planifiée en un capitalisme d'État ouvert à l'entreprise privée, aux investissements étrangers et au commerce.
Les gouvernements occidentaux ont fini par adopter les réformes de Deng Xiaoping, aboutissant à l'admission de la Chine à l'OMC en 2001. Cependant, les événements de la place Tiananmen en 1989, l'effondrement du communisme en Europe de l'Est et l'implosion soviétique ont tous convaincu les dirigeants chinois que la réforme politique était trop dangereuse. Le monopole du pouvoir par le Parti est devenu non négociable et le demeure encore aujourd'hui.
Pourtant, la révolution économique de Deng Xiaoping fut un succès spectaculaire. La Chine a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté, a maintenu une croissance annuelle de près de 10 % pendant deux générations et est devenue une économie à revenu intermédiaire de 1,4 milliard d'habitants, qui est aujourd'hui à la pointe mondiale dans de nombreuses technologies de pointe.
La révolution politique de Trump
Et maintenant, tournons-nous vers Washington. Est-il juste de qualifier de révolution ce qui se passe aux États-Unis ? Il est trop tôt pour l’affirmer avec certitude, mais je suis de plus en plus convaincu que oui.
Le président des États-Unis affirme que la plus grande menace pour l'Amérique ne vient ni de Pékin, ni de Moscou, ni des terroristes. Les véritables ennemis, prévient-il, sont les membres du parti politique adverse : leurs sympathisants, leurs collecteurs de fonds et donateurs, et même leurs électeurs. Le président Trump estime que son retour au pouvoir lui permet – exige ! – la suppression de tout contre-pouvoir politique limitant son autorité exécutive.
Il n'y a pas vraiment de révolution économique ici. Certes, Trump a imposé les droits de douane les plus élevés depuis les années 1930. Certes, il tente de saper l'indépendance de la Réserve fédérale. Et certes, il s'adonne au capitalisme d'État – actions privilégiées d'US Steel, participation de 10 % dans Intel, commission de 15 % sur certaines ventes de puces Nvidia et AMD. Mais ce sont des mesures ponctuelles, des décisions marginales dans le contexte plus large de l'économie américaine. Ce ne sont pas des principes.
Trump choisit les gagnants et les perdants pour affirmer son pouvoir, récompenser la loyauté et s'octroyer des rentes. Il n'y a aucune transformation structurelle du fonctionnement des marchés ni de la manière dont le secteur privé interagit avec le système réglementaire (et s'en empare souvent). Il n'y a pas de restructuration stratégique du capital. En réalité, le président Trump a abandonné sa promesse phare de 2016 : « assainir le marigot ». La corruption et les conflits d'intérêts ne constituent pas une révolution économique. Ils sont monnaie courante dans le système capitaliste américain, de plus en plus défaillant… simplement mieux tolérés aujourd'hui.
Mais une révolution politique est une autre affaire. Le président Trump consolide son pouvoir exécutif en repoussant les limites de la légalité. Il usurpe des pouvoirs traditionnellement dévolus au Congrès, aux tribunaux et aux États. Il a cherché à affaiblir son opposition politique afin de s'assurer qu'elle ne représente plus une menace pour lui et ses alliés. Il s'agit en partie d'une approche opportuniste du pouvoir, propre à Donald Trump. Mais c'est aussi une vengeance politique, une forme de représailles contre ceux qui, selon lui, lui ont fait subir le même sort.
Le président Trump a accusé l'administration Biden d'instrumentaliser le ministère de la Justice pour l'emprisonner et de promouvoir une approche de « culture de l'annulation » à l'égard des discours de droite, notamment en le "déplateformant" lui-même des médias sociaux après les émeutes du Capitole du 6 janvier.
Trump affirme que la gauche américaine l'a diabolisé, lui et ses alliés, en les qualifiant de «fascistes», ce qui encourage la violence politique, et il peut citer deux tentatives d'assassinat dont il a été victime durant la campagne électorale de l'année dernière ainsi que le récent meurtre du militant conservateur Charlie Kirk pour étayer son propos.
Les choix du président ont des conséquences considérables et durables. Aux États-Unis, il a obtenu la loyauté totale du Parti républicain et le soutien indéfectible des élus républicains pour ses programmes législatifs et exécutifs révisionnistes.
Il a entrepris une purge massive de la bureaucratie américaine – que Trump et ses partisans qualifient d’« État administratif » – et a remplacé les fonctionnaires de carrière par des personnes nommées pour des raisons politiques et qui lui sont personnellement fidèles. Il a instrumentalisé les « ministères du pouvoir » – le FBI, le ministère de la Justice, le fisc et de nombreuses agences de réglementation – contre ses adversaires politiques nationaux. Enfin, il a garanti l’impunité du pouvoir exécutif face aux décisions d’un système judiciaire certes indépendant, mais qui n’est plus l’égal du président.
En résumé, le président Trump remplace l'état de droit par le règne de Don aux États-Unis, tout comme il adopte la loi de la jungle – où les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent – sur le plan international.
Contrairement aux révolutions de Gorbatchev et de Deng Xiaoping, la révolution de Trump ne suit aucun grand plan stratégique. Il s'agit plutôt d'une campagne de pression incessante visant à tester les limites du possible sur tous les fronts politiques – une volonté d'agir de manière opportuniste, les crises engendrées par ces politiques ouvrant de nouvelles perspectives pour consolider toujours plus de pouvoir. Ce plan a été lancé en ciblant les opposants de Trump les plus vulnérables et les moins organisés, tels que les immigrés sans papiers, les détenteurs de carte verte, les personnes transgenres et les universités d'élite. Depuis, l'administration s'est étendue aux catégories politiques plus larges des financiers, des soutiens et des complices de ses adversaires. Tout cela est entrepris dans le but de normaliser des comportements longtemps restés tabous politiquement.
La révolution de Trump réussira-t-elle ?
Que peut encore accomplir le président Trump d'ici les élections de mi-mandat de l'année prochaine ou d'ici le jour de l'élection de 2028 ?
C'est en partie une question de degré. Les États-Unis souffrent déjà d'un biais structurel en faveur des Républicains en raison du système du collège électoral qui régit l'élection du président. Un candidat peut remporter le vote populaire et pourtant perdre la présidence à cause de la répartition démographique et géographique des grands électeurs, qui confère un avantage d'environ deux points de pourcentage aux candidats républicains. Si l'on ajoute à cela un découpage électoral agressif – les deux partis manipulant les cartes des circonscriptions – les élections deviennent encore moins représentatives, moins compétitives et moins légitimes.
Plus inquiétant encore est le risque que le président Trump déploie la Garde nationale dans les villes démocrates sous prétexte d'« état d'urgence nationale » afin de réduire la participation électorale. Les enquêtes fédérales déjà en cours sur le financement et l'organisation des démocrates accentuent ces pressions, rendant ces tactiques de plus en plus plausibles – et l'élection est encore à plus d'un an.
Soyons clairs : je ne suggère pas que Trump brigue un troisième mandat ni qu’il suspende les élections. La Cour suprême bloquerait les deux. Mais des élections non compétitives ? Des élections qui ressemblent davantage à un système monoparti qu’à une démocratie représentative et compétitive ? Avec la remise en question des contre-pouvoirs présidentiels, cette hypothèse devient de plus en plus plausible.
L'emprise de Trump sur le Parti républicain et les divisions actuelles au sein du Parti démocrate font que le pouvoir législatif est moins indépendant du pouvoir exécutif. Même si les démocrates reprennent la majorité à la Chambre des représentants (un basculement du Sénat est très improbable), ils n'auront aucun pouvoir pour faire appliquer les citations à comparaître ni pour contraindre un pouvoir exécutif récalcitrant à coopérer à leurs efforts de contrôle.
Le pouvoir judiciaire américain demeure indépendant, mais son influence est désormais bien moindre que celle du pouvoir exécutif. La Cour suprême, consciente que Trump pourrait refuser d'appliquer les décisions qui lui déplaisent, limite régulièrement la portée de ses arrêts afin de préserver sa propre légitimité institutionnelle. Bien que les juridictions inférieures soient moins contraintes, leurs décisions peuvent être, et sont souvent, cassées, ce qui donne à Trump une plus grande marge de manœuvre pour consolider son autorité.
Les médias, contraints par des propriétaires soucieux de profit, subissent des pressions de leur hiérarchie pour éviter de s'aliéner la Maison-Blanche. Les réseaux sociaux sont de plus en plus contrôlés par les alliés politiques de Trump (ce qui sera d'autant plus vrai après la finalisation de la vente de TikTok) et, dans le cas de Truth Social, par Trump lui-même.
Il existe encore aux États-Unis des institutions capables de contrôler le pouvoir présidentiel. L'armée demeure un bastion du professionnalisme – malgré la loyauté aveugle du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, envers le président – car sa culture continue de privilégier le service de la nation à la loyauté envers un individu. Les purges menées par le Pentagone à l'encontre de certains officiers supérieurs ont fait les gros titres, mais sans commune mesure avec celles intervenues en Chine la semaine dernière – et elles ne compromettent en rien l'intégrité opérationnelle fondamentale des forces armées.
La décentralisation du pouvoir politique vers les États et les villes offre également une protection. Nombre de gouverneurs et de maires américains sont des technocrates compétents qui gouvernent indépendamment de Washington. Les tentatives de Trump pour affaiblir le pouvoir national démocrate ne menacent pas la gouvernance au niveau des États et des villes.
Les dirigeants d'entreprises et du secteur financier, mal à l'aise face aux bouleversements politiques, ont tendance à éviter les confrontations politiques susceptibles de compromettre leurs intérêts et ceux de leurs actionnaires. La plupart privilégient alors l'influence réglementaire.
Et puis il y a le peuple américain lui-même. Plus de cinq millions d'Américains ont participé ce week-end à des milliers de manifestations « No Kings Day » à travers le pays, les plus importantes depuis la guerre du Vietnam. Le président Trump est un président historiquement clivant et impopulaire. Mais le Parti démocrate de 2025 l'est tout autant.
N'oublions pas : Trump a été élu librement et équitablement en grande partie parce qu'il incarnait le bouleversement politique et culturel que réclamait une majorité d'électeurs. La plupart des Américains qui se disaient attachés à la démocratie en 2024 ont voté pour Trump , et non contre lui, précisément parce qu'ils étaient convaincus que le système était déjà défaillant et que lui seul offrait un espoir de changement.
Le sort de la révolution politique de Trump est incertain, mais au vu des tendances actuelles, une crise constitutionnelle avant les prochaines élections semble de plus en plus probable. Les scénarios possibles vont d'une rupture des Républicains avec Trump à une transition politique durable vers un régime de parti unique aux États-Unis. On ne peut pas non plus exclure le chaos politique, les réalignements et les violences qu'a connus l'Amérique dans les décennies qui ont suivi la guerre de Sécession.
Une chose est sûre : les États-Unis ne reviendront pas à la culture politique qui prévalait il y a dix ans, avant que Donald Trump ne descende l’escalator de la Trump Tower. Plus tôt le monde l’acceptera, plus tôt il pourra trouver comment réagir et s’adapter à un nouvel ordre post-américain. J’y reviendrai la semaine prochaine."
Suivez Ian et GZero sur leur site ci-dessous :
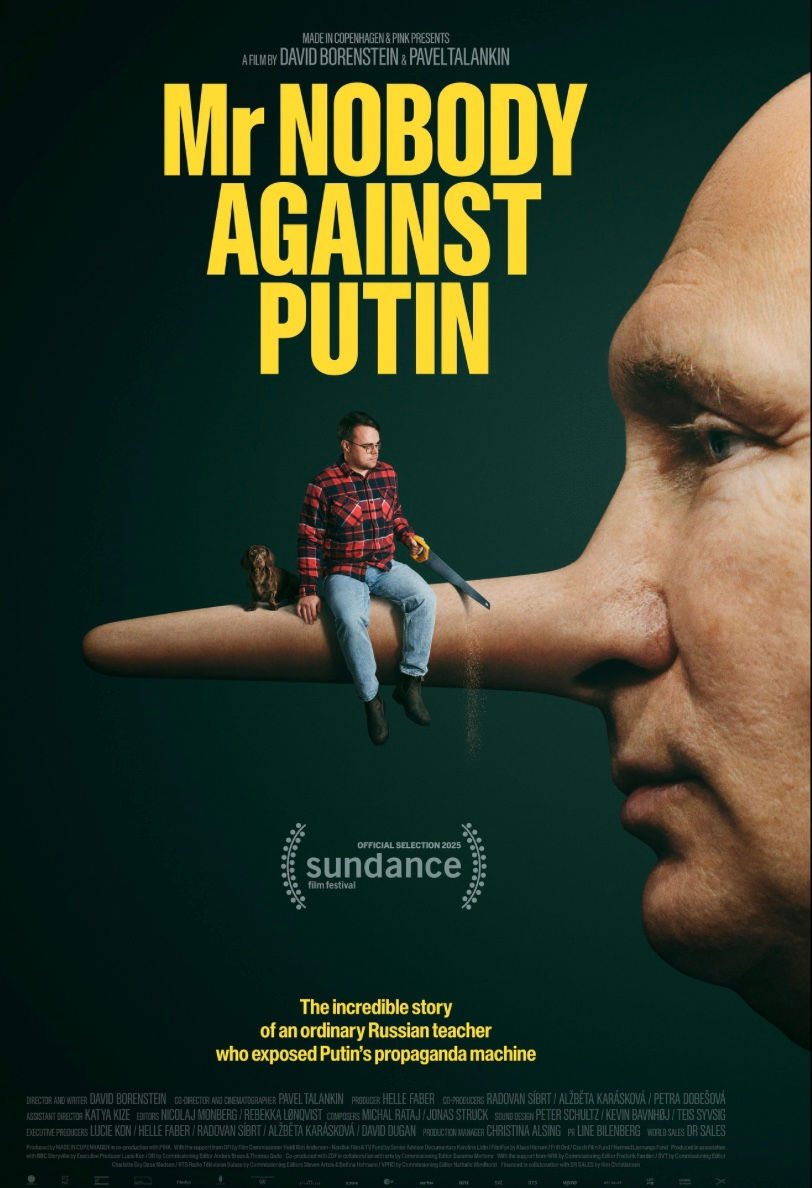


Commentaires